Sur la route des gens bien bien bien
- urbedall
- 25 mars 2016
- 5 min de lecture
Après Punta del Diablo, il a donc fallu reprendre la route. Etant inscrit dans une formation de permaculture à 150km de là, vers l'intérieur du pays, et donc sur des routes aussi improbables que François Hollande est socialiste, nous devions prendre nos précautions.
En ce dimanche après-midi touchant à sa fin - le soleil se couche définitivement à 19h30 ici - il nous fallait trouver, comme chaque journée de baroude, un endroit pour dormir et de l'eau pour la toilette et le riz (et assez d'eau, si possible, pour ne pas utiliser l'une pour l'autre). Au bord de la route, nous tombons sur un étrange épouvantail monté sur son vélo, accroché à deux mètres au-dessus de nos têtes dans un arbre. Sûr et certain, c'était le bon endroit pour demander (assez) d'eau. On a beau savoir que le hasard n'existe pas, on n'en est pas moins émerveillés des rencontres que la vie nous offre.
Après avoir appelé à plusieurs reprises, nous nous décidons à nous engouffrer dans le chemin. Au bout, une « scène des étoiles », une végétation luxuriante entourant une petite maison et surtout, à l'intérieur, Mochi. Nous nous rendons rapidement compte qu'elle n'est pas une « locale » : Indienne Guarani d'Argentine, autant son visage fier et déterminé que son caractère le montrent. Mochi s'est installé en Uruguay il y a vingt ans et y vit avec son fils, Fabian, qui a à peu près notre âge. Elle a choisi ce pays « pour les énergies extraordinaires qu'il recèle». Et à ce sujet, pas de doute, elle sent les choses. Elle comprend sans qu'on n'en dise rien que, nous aussi, nous avons choisi ce pays : «et vous, pourquoi vous avez choisi l'Uruguay ? Vous savez pas trop ? Ben voilà » nous dit-elle devant notre étonnement de cette si belle description du pays.
Dans le même temps, non seulement elle nous offrira l'eau de son puits, mais elle nous proposera de rester dormir sur son terrain, prévu pour les voyageurs de passage, entre la balançoire, le trapèze et la fameuse « scène des étoiles ».
Et alors que ce ne devait être qu'un bivouac, ce fut très, très compliqué d'y partir : nous avions comme le sentiment que nous nous devions mieux la connaître, et qu'elle et Fabian avaient beaucoup à nous apporter. Et puis, elle aura vite senti nos intentions, aussi, en nous proposant, sans que l'on ne parle de nos projets, de nous louer un hectare de son terrain, pour « un projet alternatif ». Oui, décidément, il faudra qu'on y retourne...
Maïa, elle, tombera sous le charme de son petit chiot tout blanc, Sol. Tant et si bien qu'elle ne voulut pas partir avant de lui dire au revoir. Quand enfin ce fut fait et également après une longue séance d'abrazos avec nos hôtes, Mochi nous interpella avant de partir : « j'ai eu une illumination ! Comme je dois partir à Buenos Aires, je devais laisser Sol chez une amie, mais en fait, je crois qu'il faut que ce soit Maïa qui le prenne ». Ayant prévu d'aller à Aigua, lieu de notre formation en permaculture, elle pourrait le récupérer à ce moment-là. S'en suivit une longue séance de réflexion : peut-on, doit-on prendre ce chiot, cette responsabilité, cette charge ? Rationnellement, c'est une folie, mais nous avons tendance, avec ces rencontres, de mettre le rationnel de côté. Maïa, elle, n'en démord pas : oui, elle veut voyager avec Sol dans la cabine, oui, elle s'en occupera toute la route. Alors, nous acceptons ce défi, laissant de côté la raison. Mais à peine installé dans la carriole, Sol fait des mamours à Maïa qui ne les comprend pas. L'idylle n'aura pas duré longtemps et nous partirons comme nous sommes partis. La suite nous donnera « raison ».
A peine avons-nous avalé deux kilomètres que mon pignon déraille. En fait, ce sera plus grave que ça : le pignon s'est complètement détaché du moyeu, impossible de le réparer. Nous voilà donc à marcher en poussant nos vélos, carriole et sacs jusqu'à Castillos, la ville voisine. 6Km sous le soleil de midi. Nous nous rendons compte de notre vulnérabilité, et des conséquences de tout ce poids transporté sur nos vélos destinés à la promenade du dimanche de la classe moyenne uruguayenne, chemisette et pull Lacoste sur les épaules, plutôt qu'à une famille de routards en sarwel portant sa caravane par ses mollets. A Castillos, on nous conseille d'aller voir Lelo, le vieux réparateur de vélos de la ville. Nous repérons son atelier par les vélos qui débordent de la porte – ici, pas de vitrine, les ateliers se cherchent parmi les maisons. A notre question : « bonjour, on ne vous dérange pas ? », il maugréera un « ça dépend » qui donne une certaine idée de son caractère. Il paraît complètement désintéressé par notre problème, prétexte un trop-plein de travail, et nous renvoie chez un de ses collègues, à 1km de là, qui nous renvoie chez lui, n'ayant pas de pignon de rechange. De retour devant sa porte, celle-ci est close. Nous attendrons une demi-heure avant qu'il nous ouvre. Et là Lelo est un autre homme : il a fait sa sieste. Et peut-être aussi a-t-il vu Maïa, et voit son rôle d'une autre façon. « Bon, qu'est-ce qu'il a ce vélo ? Ah, c'est juste ça ? Bon, c'est facile alors ». Et nous change le pignon en 10 minutes. Avec un pignon d'occasion, « car ça marche mieux » et pour seulement 150 pesos, environ 4 ,50€, « moins cher qu'au Brésil ! » - un argument commercial de poids, ici. Son caractère ombrageux, Lelo le doit sans doute à son cancer de la peau, qui l'a complètement ruiné et qui l'oblige à rester perpétuellement à l'ombre. Autrement dit, la peine maximale en Uruguay. Il finira par nous raconter sa vie, que nous comprendrons par bribes, tant l'accent des vieux ici est des plus trapus.
Nous reprenons donc la route grâce à ce nouvel ange-gardien, essayant de rattraper le retard sur nos prévisions, pour faire ces fameux 150 km en trois jours. A 17h, alors que nous avons bien roulé, comme d'habitude, il nous faut penser à trouver un endroit pour planter notre tente. Cette fois, nous voulons tenter l'hospitalité administrative du pays : nous voilà donc dans un commissariat de police, pour demander, en gros, où est-ce que nous pourrions faire du camping sauvage. Et là, bonne pioche, bueno monton dirait Maïa : le brigadier qui nous reçoit nous indique très naturellement le petit parc au bord de la rivière, où sont installées des tables et des parillas pour que les gens d'ici fassent leurs fameux asados : « Vous serez tranquilles là-bas. Et pour quelque besoin que ce soit, n'hésitez pas ! »
Alors qu'en France, tout ce qui n'est pas autorisé est par définition interdit, ici, ce qui n'est pas interdit est par définition toléré. Question de culture, ces définitions.





















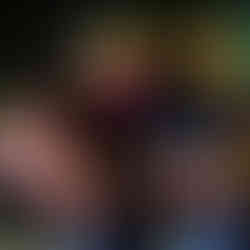

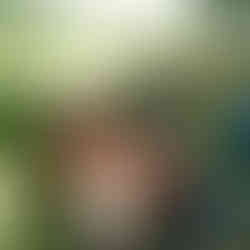















Commentaires