Des rayons et des hommes
- urbedall
- 28 avr. 2016
- 9 min de lecture
Souvent dans notre voyage, très souvent même, nous nous sommes mordus les lèvres en partant d'un endroit, en nous disant que nous partions sans doute trop tôt. A Montevideo, ce ne sera pas le cas. Plutôt le contraire : imaginez-nous postés sur nos vélos, dans notre chambre, dans les starting blocks en attendant que la pluie se calme. Et bien, c'était ça pendant 4 jours. Mais à part parfois un mortel ennui ou une absence d'idées d'activités pour Maïa, rien de grave pour nous. Ce n'est pas le cas de tout le pays : une tornade sans précédent, des trombes d'eau jamais vues depuis 50 ans. Le bilan est lourd pour des milliers de gens déplacés, qui ont tout perdu en une nuit, dans un pays où le concept d'assurance est aussi flou que la politique sociale du gouvernement français. Une occasion aussi de découvrir l'extrême précarité d'une partie de la population : à une question d'une journaliste demandant à un petit vieux pourquoi il restait dans sa maison inondée, la réponse fut cinglante : « je gagne 6000 pesos par mois (180€). Où voulez-vous que j'aille ? »
Il semble que le monde occidental se contre-foute royalement d'une telle catastrophe dans un si petit pays de rien du tout. Mais on n'invente rien.
Cette étape forcée nous aura quand même permis de fêter dignement la Journée Mondiale du Vélo, et rendu compte que la capitale compte un nombre d'adeptes plutôt important. Nous avons pu, avec des centaines d'autres collègues cyclistes, investir l'Avenue Artigas, l'équivalent des Champs-Elysées, au grand dam des voitures de derrière, obligés de suivre le rythme des pédales. Jouissif, quand on connaît les frayeurs qu'occasionnent cette rue en temps normal. Et puis, les organisateurs avaient bien fait les choses, avec notamment un festival de musiques à pédales. La règle du jeu est la même que pour le film, que nous avions vu avec efectocine il y a quelques semaines : pour faire marcher la sono, il faut pédaler ! Idée ô combien originale, qui a poussé le groupe de ska local à proposer un concert sans guitare électrique pour ne pas épuiser les mollets des pourvoyeurs d'énergie. Il y a des styles de musique plus ou moins pédalo-compatibles....
Le réseau d'associations pro-vélos organisateur de l'événement est d'ailleurs bigrement dynamique. Hartley (si, si, il se présente toujours en semblant maudire ses parents) nous explique que l'Uruguay est un pays 100% énergie renouvelable en ce qui concerne la production d'électricité. Aujourd'hui, il est à un tournant : d'un côté, une volonté, avec des relais politiques, de limiter l'utilisation de la voiture individuelle, et de l'autre, des prospections de Total au large du pays sur d'éventuels gisements de pétrole, avec d'autres relais politiques. Laurène, Française rencontrée peu de temps avant, femme d'ingénieur travaillant sur la base de l'entreprise qui n'était pas propriétaire de l'Erika, n'y va pas par quatre chemins : « j'espère pour eux (les Uruguayens) qu'ils ne trouveront pas de pétrole. C'est le début des ennuis ». Laurène, qui n'en est pas à son premier pays en tant que femme d'expat', sait de quoi elle parle. Et on aurait tendance à suivre son avis.
Et puis, enfin, le soleil fit son apparition. Bon, n'exagérons pas, ce n'était que quatre jours de flotte d'affilée, pas de quoi faire paniquer des Bretons. Mais de ce côté-là, c'est surprenant comment on peut devenir très vite Uruguayens. En tout cas, nous avons pu sortir des starting-blocks et mettre nos roues dehors, direction Colonia del Sacramento, 180 bornes à l'ouest. Un voyage pendant lequel nous maudirons les paroles du cycliste militaire rencontré quelques temps auparavant sur la route de Minas : « la route pour Colonia ? Ennuyeuse, tellement c'est plat ! ». Peut-être était-ce une blague, mais l'inconvénient avec les militaires, c'est qu'on a du mal à distinguer quand ils plaisantent. Nous, on l'a cru, tellement heureux d'avoir l'avis d'un être humain qui pédale plutôt que d'un autre installé confortablement au volant de sa voiture. On n'aurait pas dû : la route n'est qu'une succession de côtes et de descentes et ce n'est pas exagéré – vraiment pas – de dire que nous n'avons pas vu un seul tronçon de la route plat. Il y a des fois, dans nos vies mouvementées, où nous rêvons de la platitude des choses. Là, très concrètement, c'était le cas. Surtout que ce périple de quatre jours a été en grande partie une histoire de rayons.
A peine étions-nous enfin sortis de Montevideo, avec ses camions hurlant, ses absences de bandes d'arrêt d'urgence et encore moins de pistes cyclables, que j'entends un bruit reconnaissable à l'arrière de mon engin : c'est un rayon de la roue arrière qui casse, pour la deuxième fois. Malheur ou bonheur, la machine casse avant l'homme. Bienvenue das la monde made in China.
Après s'être informé dans une station-service, nous trouvons un réparateur de vélos à 3 kilomètres de là. Jorge nous accueille, un peu embarassé : « vous voulez que je la répare tout de suite ? Mon atelier s'est écroulé pendant la tempête, c'est pas évident. » Il nous montre en effet un semblant de structure en tôle qui n'a rien à envier à la Tour de Pise, derrière lui. « Bon, je vais vous faire ça, mais il faut d'abord que je retrouve mes outils ». La sérénité des Uruguayens après une telle catastrophe nous semble tout bonnement incroyable. Jorge ne se plaint pas, garde son sourire, retapera son atelier quand il aura le temps, entre deux coups de main. La réparation de deux rayons nous coûtera 50 pesos, 1,50€. Jorge aura pris une heure de son temps pour le prix d'une demi-bouteille de bière. Je lui demande si ça tiendra, s'il n'y a pas un risque que ça casse de nouveau, avec tout ce poids. Il plisse les yeux, ne semble pas comprendre, et répond finalement : « ben, si ça recasse, tu iras voir un réparateur. Non ? » C'est cette même façon de vivre au jour le jour qui permet à Jorge et à pas mal d'Uruguayens de prendre une tempête qui détruit son atelier avec une philosophie toute stoïcienne, et en même temps de ne pas prévoir l'avenir. Inch'Allah, demain est un autre jour.
Grâce à Jorge et à 50 pesos, donc, nous reprenons la route. Après quelques dizaines de montées et descentes, la journée, bien entamée par le laps de temps nécessaire à la réparation dans un atelier ravagé, prend fin. L'automne arrive et avec lui un coucher de soleil vers 18h30. Nous demandons de l'eau à la première station-service, puis décidons de demander aussi l'argent du beurre : pouvoir poser notre tente pour la nuit. Il faut dire qu'il y a dans cette station une douche bien chaude que doit apprécier pas mal de camionneurs. Pas de problème, comme souvent : nous plantons donc notre tente à la surprise de nombreux clients passant un peu interloqués devant notre campement. Le lendemain matin, l'accueil du responsable de la station-service sera moins serviable, nous intimant de dégager rapidement, nous soupçonnant aussi de nous être installé sans demander la permission. On ne sait si c'est nous, si c'est l'hiver imminent qui rend les gens plus ombrageux, où des spécificités culturelles, mais les Uruguayens nous paraissent moins sympa depuis Montevideo – même si l'avenir nous donnera tort. En tous les cas, on ne philosophe pas plus, et on prend la poudre d'escampette.
Pas pour très longtemps : au bout de 10 kilomètres, ce sont deux autres rayons qui cassent. Au premier village, on apprend qu'il n'y a pas de réparateur de vélos ici. Parole de mécanicien moto : « aujourd'hui, de plus en plus d'Uruguayens abandonnent le vélo pour la moto. Donc les ateliers vélo ferment les uns après les autres ». Un autre symptôme chinois envahit l'Uruguay, ce qu'un syndicaliste rencontré à Montevideo qualifiera de progrès social du à l'augmentation du pouvoir d'achat est désastreux écologiquement. Et problématique pour nous, à qui on conseille de faire demi-tour de 10 kilomètres. Pas question de faire subir ça à nos guibolles, on décide de tenter notre chance de l'autre côté.
Bingo : ce sera un rayon de soleil qui nous accueillera au village d'après. Bruno est réparateur de vélos par nécessité : travailleur rural – l'esclavage moderne uruguayen, soyons clairs – il a créé son petit atelier pour gagner un peu plus que la maigre pension de retraite qui lui permet à peine de vivre. Il nous reçoit avec un jeu tout uruguayen, que nous commençons à connaître : « et vous voudriez que je répare ça maintenant ? » Oui, si possible, mais sinon on peut attendre, répond-on en substance. « C'est compliqué, je vis tout seul et je dois préparer à manger vous voyez ». Il est 11h30, les Uruguayens mangent rarement avant 13h. Alors, on lui propose de lui acheter quelque chose à manger. « Noooooon, pas de problème, j'ai le temps. Alors qu'est-ce qu'il a, ce vélo ? ». Comprenne qui pourra. Nous restons discuter tranquillement, sur notre voyage, sur la vie en Uruguay, sur son bonheur de rencontrer des étrangers, ici, dans son petit village. Après avoir changé trois rayons, c'est le moment de payer. Bruno refuse. « On est un petit pays, on a ce devoir de bien accueillir les étrangers qui nous font l'honneur de venir nous visiter ». On parle bien d'un type qui répare les vélos à 70 ans pour se payer à manger. Nous lui offrirons le dernier pâté de sardine de Bretagne qui nous restait, et lui demandons de prendre une photo. Avant de repartir, il nous demande de patienter quelques minutes, et revient avec une tablette blanche flambant neuve pour prendre à son tour une photo. Dans ce décor de bidonville, c'est peu dire que cet instrument high tech détonne. « Quand on arrive en retraite, l'Etat uruguayen nous offre à tous une tablette » nous explique-t-il, essayant tant bien que mal de comprendre le fonctionnement de cette drôle de machine. Dérisoire politique « sociale » de l'Etat. Comme beaucoup de vieux Uruguayens, Bruno préférerait avoir assez d'argent pour manger que de « rentrer dans le 21ème siècle » comme disent ceux qui ont le ventre plein.
La roue tiendra cette fois vingt kilomètres avant de tituber de nouveau. Je finirai les dix derniers kilomètres avec un rayon en moins et sans frein pour laisser libre cours à l'expression de cette roue devenue folle. C'est devenu officiel : nous sommes trop chargés, en tout cas par rapport à ce que peut supporter une bicyclette faite pour les sorties du week-end. Arrivée dans une petite ville au carrefour des routes de l'intérieur et du littoral, nous nous décidons d'aller sentir l'esprit d'accueil de la police locale. « Vous cherchez un endroit pour dormir ? demande la policière de faction. Mais bien sûr, il y a le parc là, juste en face, il y a des sanitaires, un robinet. Et si vous avez besoin de recharger votre ordinateur ou votre appareil photo, ou si vous avez besoin de réchauffer quelque chose, revenez nous voir, ok ? » Que la vie peut être simple, parfois - entre deux rayons cassés - en Uruguay. Trop facile, même. Le parc en question est aussi un petit zoo, avec une aire de jeu, de quoi ravir Maïa également. Quant à cette satanée roue, j'arrive à trouver un réparateur semblant comprendre mon envie de ne pas attendre que les rayons se cassent les uns après les autres. Le lendemain, pour la première fois, elle tiendra tout le trajet. Ouf...
Cette étape devait être courte : nous avions prévu de nous arrêter dans un village nommé Nueva Helvecia, et réputé pour être, comme son nom l'indique, une petite Suisse. Mais au même titre que moi et Maïa préférons Maradona à Messi, si on a envie d'aller en Suisse, on va en Suisse. Pas besoin d'une pâle copie. Le village est peut-être original pour les Uruguayens, beaucoup moins pour nous. Surtout qu'ici, ils ont décidé de copier la Suisse jusqu'à ses racines philosophiques : si tu n'as pas de thunes, tu peux partir. Nous refusons l'hôtel miteux et l'accueil d'enterrement qui va avec pour 55€ et reprenons nos biclous. A 20 kilomètres de là, Rosario (l'Uruguayenne) est un village uruguayen classique et ça nous plaît bien plus. Au premier hôtel indiqué, nous demandons le prix de la chambre à la gérante. Nous faisons la moue : c'est un peu cher pour nous. « Sinon, il y a un autre hôtel à quelques pâtés de maison, c'est le moins cher. Vous voulez que je les appelle ? » A peine a-t-on répondu qu'elle a déjà sa collègue au téléphone, et négocie pour nous : « ils sont trois mais la petite dort avec eux, du coup ça peut être une chambre pour deux ». Une fois le téléphone raccrochée, nous demandons quand même à cette dame qu'est-ce qui fait qu'elle préfère aider les gens et les amener à la concurrence plutôt que les retenir ici – surtout que nous n'étions pas loin d'accepter son tarif à elle. « Nous, les Uruguayens, nous sommes un petit pays, nous devons être solidaires. Et c'est très important pour nous de savoir les gens qui nous entourent satisfaits, heureux. C'est comme ça que nous sommes heureux, nous aussi. C'est notre philosophie. » Tout est dit.
Nous arriverons finalement à Colonia del Sacramento sans encombre et en évitant (presque) complètement la pluie. Avec une petite émotion : au même titre que cette ville était un objectif de notre voyage, elle ponctue une traversée du littoral uruguayen à vélo. Si dans un voyage, la destination n'est jamais le plus important, il y a des arrivées qui font oublier un paquet de rayons.

























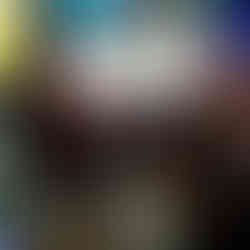











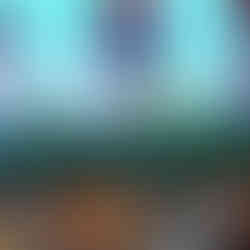









































Commentaires