En revenant à la maison
- urbedall
- 27 juil. 2016
- 6 min de lecture
Nous avons donc fêté nos premiers anniversaires en hiver. Si celui de Céline était un vrai de vrai, à 2 centimètres du feu de cheminée pour se tenir chaud, le mien aura été un peu faux – mais pas de quoi s'en plaindre : ce 9 juillet était notre dernier jour en terre d'Iguazu, où Sylviane n'a pu s'empêcher de nous payer le meilleur resto – et de loin – depuis notre arrivée. Cela nous a permis de déguster, enfin, pour de vrai, ce qu'est la bonne viande argentine. Car en Uruguay comme en Argentine, ces pays si réputés pour leur bidoche, c'est (presque) toutes les carcasses de qualité qui partent en containers entiers à l'autre bout du monde, chez ceux qui ont de l'argent. Dans le tiers-monde, les avantages acquis du libre-échange se voient toujours comme les yeux au milieu de la figure. Alors, depuis notre arrivée, nous étions presque devenus végétariens tant la viande proposée nous ragoûtait si peu, obligeant même Céline à la rendre à la nature en pleine nuit, après dégustation d'un de leurs fameux choripan.
Nous prenons le bus en fin d'après-midi pour la nuit, cachant de quoi fêter l'anniversaire dans nos bagages à main, comme des ados – à la différence près que nous avons, depuis, opéré un saut qualitatif, une bonne bouteille de vin remplaçant les canettes de bière-pas-chère. Il nous fallait bien ça pour essayer de dormir un peu avant d'arriver, avant l'aube, à la frontière argentino-uruguayenne. Là, on nous informe qu'il n'y a pas de bus le dimanche pour rejoindre Salto, du côté uruguayen. Et vous l'aurez compris, on est donc dimanche. Or la loi argentine est très claire : pas plus de quatre personnes dans un taxi ; avec une précision on ne peut plus gynécologique : une femme enceinte compte pour deux. Rassurez-vous (ou pas), pas de femme enceinte (connue) chez nous, mais nous sommes cinq. Et si un fœtus compte pour un, peu de chances de négocier pour que Maïa ne compte pas. Mais comme à chaque fois que nous avons eu besoin du taxi durant le voyage, une bonne âme a accepté de nous prendre tous, se faisant légitimement payer une prime, non seulement pour le risque encouru, mais aussi, surtout peut-être, pour devoir supporter ensuite les regards amers de ses collègues, nous voyant partir en ruminant leur maté du matin.
Nous revoilà donc en Uruguay. Arrivés à Salto, Jacinto, chez qui nous louons un petit appartement pour une nuit, nous attend au terminal de bus. Il a laissé sa grande famille – 8 enfants quand même – au petit matin pour venir nous recevoir. Et c'est le plus naturellement du monde qu'il nous enverra un peu plus tard aux thermes, la spécialité de cette petite localité frontalière. On nous avait déjà parlé de la gentillesse et de la générosité des Uruguayens de l'intérieur, dédaignés par ceux de Montevideo et de la côte, les traitant de ploucs locaux. Mais ce petit aperçu de la plouquitude uruguayenne nous donnera envie d'y retourner : même si les Uruguayens sont réputés pour leur tranquillité, ici, la coolitude bat son plein. Avec, aussi, une gentillesse et une générosité naturelles, comme ce père de famille offrant à Maïa le ballon de sa fille – qui était tout sourire d'offrir ce cadeau – quand ils sortirent du bain. Il faut l'admettre : on ne connaît pas encore grand-chose de l'Uruguay. Et c'est tant mieux.
L'autre spécialité de Salto, c'est de fournir à l'équipe nationale de foot ses attaquants vedettes : Suarez et Cavani sont nés ici, par une coïncidence troublante. C'est donc dans une ville de foot que nous voyons, à la télé, celui qui se prend pour le meilleur footballeur de la planète – à la place de Suarez, diraient les Uruguayens - soulever la Coupe d'Europe après avoir joué dix minutes de la finale. C'en était trop, il nous fallait partir.
Nous faisons une halte à Montevideo où nous découvrons – enfin – le café préféré d'Eduardo Galeano, notre maître à penser uruguayen, cet écrivain unique qui aimait décrire les cafés de Montevideo comme « son université ». Le café brasileiro est effectivement un de ceux où « il y a le temps pour perdre son temps », comme il aimait le célébrer.
Et puis, encore du bus, une dernière fois. C'est la maison de Fabrice, notre ami millionnaire, qui nous attend. Il nous avait en effet proposé de profiter de son autre maison, un palais en bois posée juste devant la plus belle plage de La Pedrera, une de ces stations balnéaires magnifiques, bondées en été et désertes en hiver. Cette maison est habitée par le gérant de son complexe de cabanas, qui se trouve à deux pas. Celui-ci étant en vacances à l'autre bout du monde, il a quand même fallu négocier avec sa mère, Nilsa, qui semblent s'être quelque peu octroyé l'usufruit de ce bien. Finalement, la mère acceptera de nous laisser les clés, en les cachant tellement bien dans le jardin qu'il a fallu l'aide d'une de ses amies pour les découvrir, et après nous avoir fait croire que La Pedrera est un repaire de bandits assoiffés de sang et de porte-monnaie l'hiver venu. Nous n'aurons rien vu de tout ça, mais plutôt ce qui ressemblerait à un petit paradis sur terre : de la grande baie vitrée de l'étage, nous avions une vue imprenable sur l'océan ; il suffisait de mettre un pied dehors pour se retrouver sur la plage ; et quand le sable nous saoulait, on pouvait se réfugier dans le jardin, à l'abri du vent, avec comme bruit de fond la douce mélodie des vagues s'échouant sur le rivage. Sans doute est-ce parce que l'être humain s'embourgeoise très rapidement, nous aurons quand même le culot d'avoir une petite déception : c'était le tout début de la période de migration des baleines, qui passent se balader par là. Donc, théoriquement, devant notre baie vitrée. Malheureusement, malgré une fausse alerte de Sylviane qui ébranla toute la maison, pas une trace de la plus petite baleine qui soit. Dommage pour nos deux voyageuses, partie remise pour nous.
Et puis, les vacances de Grand-Mère et Tata Lulu devaient bien prendre fin. Après trois jours de luxe, nous sommes donc revenus à notre dure réalité de locataire d'une cabane dans une favela. Oui, pour le dire simplement, ça change. La mère Nilsa devrait passer ses vacances à Marindia pour se rendre compte que sa description cataclysmique de La Pedrera l'hiver conviendrait mieux à cette petite peuplade posée sur le sable du Rio de la Plata. Depuis deux mois, au fur et à mesure de nos rencontres, nous nous sommes aperçus que Marindia n'avait pas bonne presse par ici. Nous comprendrons notamment que la municipalité de Montevideo a volontairement « nettoyé » un de ses quartiers chauds, invitant les habitants à se délocaliser à 40 kilomètres de là, où « l'accession à la propriété », comme ils disent, est facilitée par un prix du m² défiant toute concurrence. Nous ne nous étonnons donc plus quand nos interlocuteurs ont un mouvement de recul lorsqu'on leur informe de notre lieu de résidence, ou lorsqu'ils demandent si nous sommes du côté sud de la quatre voies, toujours réservé aux riches, ou du côté nord dont les rues, comme un symbole de la discrimination sud-américaine, portent des noms d'Indiens ou de localités indiennes. Chez nous, au nord, il faut l'avouer, des coups de feu agrémentent parfois nos soirées. On aurait voulu l'éviter, mais nos invitées ont eu l'occasion, pour leur dernière nuit uruguayenne, d'entendre cette autre douce mélodie nocturne, après celle, omniprésente, des chiens qui aboient. Malgré tout, paradoxalement, et sans être naïfs, nous ne nous sentons pas pour autant en insécurité ici.
Comme trois semaines auparavant, c'est la pluie qui accompagna notre trajet jusqu'à l'aéroport, et cette fois, ce sont des larmes qui accompagneront Maïa à notre retour à la maison. Elle s'était évidemment habituée à la présence de ce bout de famille importé, et ce fut d'autant plus compliqué de la consoler que ce retour à la maison sous la pluie, après la magie d'Iguazu, ne nous enchantait pas plus que ça non plus. Mais comme souvent, tout s'est amélioré avec le soleil. Il revint deux jours plus tard, pour une des deux fêtes de l'Indépendance – car dans le pays du carnaval le plus long, les excuses pour faire la fête sont légion. Alors que nous étions à Montevideo pour un concert la veille, nous rencontrons un défilé sur une des principales rues de la ville, la bien nommée 18 de julio. Ici, point de garde montée ou d'exhibition de la puissance militaire de la nation, mais une armée de gauchos chevauchant leur canasson, défilant avec leurs habits du quotidien, donc parfois en jogging, criant avec vigueur « viva la Patria! » Des gauchos de tous âges, dont des bambins pas plus grand que Maïa montant seuls, et fiers, leur cheval. Et pas de camion fou, ni sur cette avenue, ni à Marindia. L'insécurité n'est pas toujours là où croit.







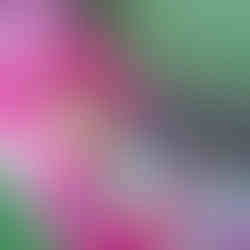











































































Commentaires