Sur le marché de la pauvreté
- urbedall
- 20 août 2016
- 7 min de lecture
On appelle ça Jugaad en Inde, système D un peu partout ailleurs dans le monde. Surtout dans le Tiers-Monde d'ailleurs. Carlos, le marionnettiste basque qui apprend à Céline à créer sa marionnette – qui prend de plus en plus forme, et c'est le cas de le dire – fut étonné d'apprendre que Céline n'avait jamais exercé un métier manuel auparavant en France. « En Europe, dès que quelque chose est en panne, on le change ou on va voir quelqu'un pour le réparer. Dans les deux cas, on est complètement dépendants des multinationales. Ici, c'est impossible, tout le monde sait réparer, et quand il ne sait pas, il va voir le voisin, qui sait. » Ou comment la précarité engendre indépendance et solidarité : rien ne peut se perdre, tout doit se transformer. Un système D qui devient un avantage comparatif certain pour cette main-d'oeuvre du Tiers-Monde dans le marché du travail mondialisé. Antonio, un type rencontré sur la place de Salinas, le village voisin, me témoignait de la success story du fils d'un ami. Celui-ci travaillait dans un mac Do, à faire tourner les steaks, toute la journée. Un jour, la friteuse tombe en panne. Et un Mac Do sans frites, c'est comme Manuel Valls sans le 49-3 : il ne peut plus travailler. Alors le team manager décide de fermer l'établissement, le temps de changer la machine. Jusqu'à ce que le travailleur immigré ose l'impensable : et si on regardait à l'intérieur de la friteuse, juste pour voir ? Le diagnostic fut aussi rapide que la réparation : un câble s'était débranché. Le lendemain, le gérant de l'établissement convoque cet Uruguayen impertinent qui, la veille, permit à l'entreprise de continuer à empoisonner ses clients et engranger des somptueux bénéfices, pour lui offrir une formation et le nommer responsable de la maintenance de ses magasins. Une success story à la mesure de l'immigré uruguayen, qui traverse son continent juste pour décrocher un emploi stable aux Etats-Unis. Les Uruguayens naissent avec des doigts qui connaîtront un autre destin que celui de taper sur un clavier d'ordinateur, à l'inverse, par exemple, de votre serviteur, et de millions d'Européens avec lui.
Notre voisin ferrailleur est de ceux-là. Et autant que des doigts à tout faire, il lui faut aussi un mental de la même trempe que les bouts de métal qui lui restent dans l'oeil pour affronter les turpitudes de la vie. Il est revenu nous voir, tapant des mains à l'entrée de la maison comme on fait ici et criant : « vecinooo ! ». Vecino, ça veut dire voisin. Il n'a pas cherché à connaître nos prénoms, et ne nous appelle que comme ça. Derrière cette dénomination transpirent la rudesse et en même temps l'affection envers son prochain que portent les gars d'ici. Vecino, c'est aussi le signe qu'on a été adopté, c'est un peu une médaille qu'on aimerait accrocher au-dessus de notre cheminée : on n'est plus des touristes, en somme. Alors, on garde ce titre d'honneur, et on fait de même. Notre voisin s'appellera donc Vecino.
Et Vecino a encore des problèmes, comme si la vie voulait lui jouer des mauvais tours. Comme la moitié du quartier, et comme nous, Vecino allait chercher son électricité en se branchant illégalement au réseau électrique. Mais quelqu'un l'a dénoncé. Pourquoi ? Il l'ignore. Toujours est-il que la compagnie nationale d'électricité sait y faire, dans un pays où les relations familiales comptent plus que tout : elle a envoyé une amende de 11000 pesos, l'équivalent de 360€, sur le compte de son frère qui, lui, paie l'électricité. Alors, en attendant de pouvoir payer – cette somme doit être l'équivalent de ses dépenses mensuelles, lui qui élève seul ses quatre enfants – il vit sans électricité le jour, de peur qu'un inspecteur de la compagnie d'électricité repasse dans le coin, et, le soir venu, il empile un frigo, une gazinière, une chaise et trois cartons, se hisse péniblement sur ce montage d'équilibriste pour aller se rebrancher – car si on trouve à peu près tout dans sa caverne d'Ali Baba de ferrailleur, aucune trace de la moindre échelle. Puis le matin, rebelote pour débrancher. Vecino risque sa vie deux fois par jour, et ça n'a rien d'une image. Alors, malgré nos invitations à venir prendre notre électricité, qui n'est pas la nôtre non plus, il décline l'offre, demandant juste de pouvoir lui faire chauffer de l'eau pour son thermos à maté. Car un Uruguayen ne peut affronter la vie sans son maté. Son frère, lui, n'a pas été très compréhensif : « Il a voulu me casser la gueule. Il m'a même cassé une dent » nous relate-t-il après son entrevue houleuse. Aux vues de sa dentition aussi clairsemée que les bonnes nouvelles qu'il ramène, on a peine à croire que son frangin ait pu en atteindre une.
On sent poindre le dépit chez ce brave homme, qui lâche un peu de sa rudesse pour nous témoigner de son découragement : « La mère des gosses ne veut plus les voir, et ne donne jamais d'argent. Et bien sûr, j'ai que dalle de l'Etat. J'ai pas d'amis ici, mais j'ai pas d'ennemis non plus, je comprends pas qui a pu me dénoncer. Et ma mère qui est malade, je dois aussi m'occuper d'elle, en plus des gamins. Y a des fois, j'suis fatigué ». Vecino survit, plus qu'il ne vit. Et on a beau lui proposer notre aide, garder ses enfants un dimanche, histoire qu'il puisse se reposer, rien n'y fait : le « muchas gracias » signifie « je dois me dérouiller tout seul ». Avec, quand même, une sensibilité toute latino, à première vue impensable chez un dur comme lui : « je dois quand même faire gaffe. Quand j'suis pas bien, les gamins le sentent, et ils sont pas bien non plus. »
Quant à nous, heureusement que notre survie ne dépend pas que des crêpes. Un dicton d'ici dit que la fin du mois commence le 15. Et c'est très vrai : au fur et à mesure des semaines, la vente en porte-à-porte devient de plus en plus difficile ; même si nous sommes ben reçus la plupart du temps, on sent bien que c'est le portefeuille qui commande. Au moins, le goût des crêpes n'est pas en jeu, car elles sont unanimement appréciées, jusqu'à Montevideo où nous avons honoré notre première commande via la pâtisserie de notre ami Jean-Luc. Et d'autres témoignages qui font du bien, comme cette jeune femme nous racontant comment elle nous a cherché dans un marché que nous n'avions pas refait, car elle avait été presque la seule cliente.
Même si celui de Salinas ne nous rend pas millionnaires, nous continuons à y aller chaque jeudi. Aussi parce que le marché, dans le monde entier, est un formidable point d'observation de la vie d'une société. Comme les autres « petits » vendeurs et vendeuses, nous nous installons sur les places restantes, une fois que tous les professionnels ont posé leurs étals et les placiers venus récupérer la location des emplacements. Gabriela est de celles-là, et, un matin, nous reçoit avec un grand sourire lorsque nous demandons si nous pouvons nous poser là, à côté d'elle. On parle de la vie d'ici, de la vie de là-bas, nous écoutons aussi les discussions aux portes invisibles, même si c'est pas bien. Mine de rien, ça nous permet d'apprendre un paquet sur la vie d'ici. Comment, par exemple, le froid gouverne aussi les loisirs. Ainsi, Gabriela s'excuse auprès d'une amie de ne pas avoir commencé le livre qu'elle lui a prêté : « tu sais, moi, je lis le soir, dans mon lit. Mais ces temps-ci, il fait trop froid, alors je ne peux pas mettre mes bras en-dehors de la couette, ils sont tout de suite gelés. » On sent venir de loin les excuses des écoliers auprès des professeurs de littérature.
La semaine suivante, c'est le même sourire qui nous accueille. Nous nous installons à côté d'elle et de Manuel, un fabricant de chaussures en cuir, autodidacte. Entre nous, le courant passe tout de suite. Son métier, qu'il a appris tout seul, c'est une manière pour lui de montrer « qu'on peut se passer du système, et arrêter d'être dépendant de la Chine ». Avec son look d'Indien « revendiqué », il n'a pas été aussi bien accueilli par Gabriela : « Tu sais, ici, on reçoit mieux les étrangers que ses compatriotes. Elle m'a demandé qu'est-ce que je foutais là ; quand j'ai vu comment elle t'a reçu, ça m'a fait bien rire ». Rire jaune, quand même. En Uruguay, les derniers Indiens Charruas ont été exterminés au début du siècle. La faute – ou grâce, c'est selon – au général Rivera, qui employa un stratagème qui restera dans les annales du raffinement militaire : il invita les derniers chefs Charruas à un « thé de la paix », préparé avec du somnifère. Une fois endormis, les Indiens furent massacrés, et leurs familles à la suite. Aujourd'hui, l'avenue Rivera est la plus longue de Montevideo, et donc d'Uruguay. « Et elle se termine par le Monument aux Indiens, complète Manuel. Ici, l'histoire a été complètement déformé par les politiques, et les Uruguayens les croient, et méprisent les Indiens qu'ils ne connaissent pas. » Manuel n'est pas Indien, soyons clairs, mais sa simple apparence rebute la plupart de ses compatriotes. Nous laissons passer un silence, sans doute en hommage à ses Indiens exterminés sur l'autel de la civilisation. Puis Manuel scrute notre stand : « C'est quoi votre drapeau de la Juventus, là ?
Non, c'est le drapeau de la Bretagne. En fait, on est un peu les Indiens de France.
Ah, ouais. Comme les Basques ?
Ouais. En France, y a les Basques et les Bretons. »
Les Corses apprécieront. On les a oublié. Volontairement, en plus.
Nous sommes aussi devenus des habitués d'un autre marché, découvert dans les pages d'un livre de notre meilleur guide uruguayen, le regretté Eduardo Galeano. A Montevideo, le marché Tristan Narvaja est une institution, une immense braderie en même temps qu'un marché alimentaire, où tout se vend. Absolument tout : le bon Eduardo parlait du temps où des dentiers étaient présentés dans une grande bassine transparente remplie d'eau. Il fallait plonger sa main dans la bassine, en choisir un, l'essayer, et s'il ne convenait pas, le replonger dans sa piscine au milieu de ses congénères. Ce temps a malheureusement disparu, et aujourd'hui, tout se vend, sauf des dentiers, donc. On y trouve tout ce qui nous manque, du jean à 50 pesos (1,50€) au matériel de cuisine en passant par des magnifiques chaussures à 200 pesos (faites le calcul, c'est bon pour la santé) pour Céline et Maïa, ou un téléphone à cadran – qui ne nous servira pas de sitôt, semble-t-il.
Un concentré d'Uruguay : vivant, joyeux, et pauvre aussi. A Tristan Narvaja, on vend aussi pour continuer à vivre.















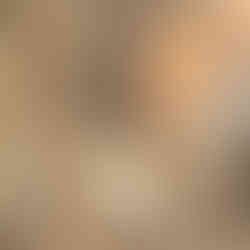

















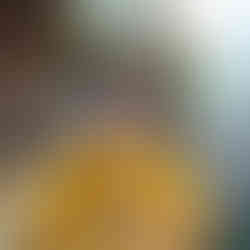













































Commentaires