La loi du travail
- urbedall
- 14 sept. 2016
- 10 min de lecture
« On est très contents que tu sois avec nous, tu nous aides beaucoup ». J'ai eu une bonne note et, mine de rien, c'était pas gagné. Je dois avouer que je n'imaginais pas ce volontariat en permaculture comme ça. Car depuis trois mois et demi, je me lève à 6h les lundi et mardi, avale 13 kilomètres à vélo et me retrouve à Isla Verde (« l'île verte »), la ferme en permaculture créée par Fred et Uta, suivi par leur fils déscolarisé, Ule. N'allez pas croire que la permaculture n'est que la nouvelle marotte des babas cool. Ou si vous le croyez, rendez vous à Isla Verde. Fred et Uta Rienow, la cinquantaine, sont originaires d'Allemagne de l'Est. Fred y a travaillé, jusqu'à ses 26 ans et la chute du Mur. Alors qu'il était marin dans une entreprise d'Etat, il profite de l'occasion de ces coups de barre à mine en mondovision pour faire valoir son goût pour l'initiative, et créé une entreprise de pêche qui aura plus de 50 salariés. Ensuite, sans doute – tant ils sont discrets sur leur passé –, c'est la prise de conscience du fait que le système est à bout de souffle, que la planète se meurt : ils vendent leur boîte et, après un détour à planter des bananes en République Dominicaine, débarquent en Uruguay. Cela aurait pu être n'importe quel autre pays : ce qu'ils voulaient, c'est un terrain pour faire de la permaculture. Autant dire que la culture uruguayenne et la sociologie de son peuple, ils s'en fichent comme du Capital de Karl Marx. Et ce n'est pas un petit terrain qu'ils acquièrent : alors qu'il est aujourd'hui prouvé qu'il est rentable de faire de la permaculture sur 1000m², eux ont... 47 hectares. A trois, c'est scientifiquement impossible de cultiver selon les méthodes de la permaculture autant de surface. Mais eux ne veulent pas le savoir : la famille Rienow célèbre « l'éthique protestante du travail », si chère à la tradition allemande, consacrant cette valeur comme absolue, celle grâce à laquelle tout est possible. Pour ma part, je ne vois pas bien en quoi s'esclavagiser soi-même en s''aliénant à ce point au travail a quelque chose d'éthique, et je crois savoir que des millions d'Uruguayens se poseraient la même question. Comme quoi, les différences culturelles ne sont pas uen affaire de kilomètres.
A Isla Verde, donc, tu travailles ou tu la quittes. Même si je ne suis que volontaire, que je ne suis par conséquent pas payé, je me rends bien vite compte qu'il n'y pas de temps pour la flânerie ici : j'arrive en même temps qu'une Etats-Unienne, censée rester trois mois. Au bout d'une demi-journée, Uta lui demandera de faire son sac. Pas assez efficace au désherbage manuel, et ça, ça ne pardonne pas. Et puis, il y aura Gonzalo, le seul Uruguayen croisé ici. Lui était plutôt efficace, mais avait un défaut impardonnable : il ne s'entendait pas avec Ule, le fiston. Il faut dire qu'il y a de quoi : sorti du système scolaire, à 13 ans, il travaille avec ses parents, et ne voit aucun enfant de son âge. Je comprendrais vite que le volontariat a d'abord été instauré pour que le petit dernier puisse voir du monde, et sortir du cadre familial stricto sensu. Mais du haut de ses treize ans, Ule préfère souvent singer son paternel plutôt qu'entretenir de bonnes relations avec les volontaires. Alors, il fait le p'tit chef, ordonnant de prendre tel ou tel outil, d'aller plus vite, ou moins vite, c'est selon, de réprimander à tout va. Je me contente la plupart du temps de répondre en le fixant du regard avec un sourire qui, j'espère, lui fait dire « pour qui tu te prends, gamin ? », et je crois que ça marche, car ça le fait parfois redescendre un peu. Parfois. Gonzalo, lui, tente une autre technique, et finit un jour par lui répondre par un très fin et pertinent : « Heil Hitler ! » Me voilà à lâcher ma fourche, et accourir vers eux pour tenter de les séparer. Dans ce Koh Lantha permaculturel, Gonzalo, lui aussi, sera aussi éliminé. Pas assez cool avec le fiston, ça ne pardonne pas non plus.
Pendant quelques semaines, je reste donc le seul volontaire, observant, perplexe le fonctionnement de cette famille où tout est très bien hiérarchisé et organisé. Fred est le patriarche, celui à qui le fils sert à manger en premier. Celui sûr de son fait, méprisant le « dialecte » des Uruguayens qu'il dit ne pas comprendre, qui n'aurait rien à voir avec le castillan – alors que lui-même aurait sans doute encore des progrès à faire dans la langue de Cervantès. Mais je me garde bien de lui dire, car il est aussi celui qu'il ne faut pas interrompre ou contredire. Une des seules fois où il parlera de l'époque communiste, il lancera : « Dans son Manifeste, Marx n'avait pas pensé à tout ». « Oui, en même temps, il a dit lui-même qu'il n'était pas marxiste, en anticipant sans doute ce qu'on allait faire en son nom, et.... ». Je m'arrête. Deux paires d'yeux tout ronds, celles d'Uta et Ule, me dévisagent, semblant me dire : « mon p'tit bonhomme, range ton analyse sociologique, tu la serviras ailleurs, ici, c'est pas comme ça que ça se passe ». J'ai compris, et je ne retenterais plus. Pas de débat, donc, et une ambiance assez pesante à chaque repas, pourtant les seuls moments de repos que la famille s'octroie, un silence rempli de non dits, où on ne sait jamais s'il est pertinent de l'ouvrir.
Je travaille souvent avec Ule, qui m'exaspère souvent. Ce gosse, comme beaucoup de son âge, veut faire des blagues, des grimaces, rigoler, embêter les autres. Etrangement, je vois sa mère laisser faire son carnaval, l'encourageant même avec ses rires forcés et crispés, alors que, par ailleurs, l'efficacité doit primer sur tout le reste. Plus tard, je comprendrais quand elle me parlera de sa fille, lycéenne en Suisse. Partie de la maison à 16 ans, elle s'est retrouvée seule, à l'autre bout du monde, dans un des lycées les plus prestigieux d'Europe, avec la grande bourgeoisie comme camarade de classe. C'en était trop : elle a tente de se suicider plusieurs fois. « On a été voir le psychologue, il nous a dit que la différence était trop grande entre Isla Verde, perdu au fond des champs, et cette école ultra-élitiste ». Fallait-il vraiment payer pour comprendre ça ?
En tout cas, Uta a donc décidé de couver son petit dernier, étant simplement heureuse quand son fils fait le con, ne veut pas travailler, ou même ralentit les autres. Au moins, doit-elle se dire, il ne pense pas à se couper les veines.
Non, Ule n'a pas ce genre d'idées. Exaspérant souvent, agréable et taquin, aussi, à ses heures il est surtout le reflet de ses parents, sûr de lui et de son savoir. Et n'hésite pas à venir me faire la leçon. Un jour, je lui raconte que moi et Maïa sommes partis sur la plage le soir, alors qu'il faisait nuit. « La lune était d'une puissance ! On voyait même nos ombres » dis-je, encore émerveillé du spectacle. Ule, lui, lève les yeux au ciel, me regarde comme s'il avait affaire à un indécrottable abruti : « Mais non, finit-il par me répondre dans un soupir, la lune n'est pas puissante : elle n'est que le reflet du soleil ». Maître Capello était lancé, rien ne pouvait l'arrêter. Et puis, à d'autres moments, on pouvait rigoler, en vrai, quand il se sentait d'humeur à sympathiser. L'avant-dernier jour, il me lancera : « alors comme ça, tu pars demain ? Tant mieux ! » Un silence passe. « Ma voix dit « tant mieux », mais mon cœur dit « dommage » ». Chiant et touchant, Ule. En somme, touchiant ?
Cependant, on sent une vraie générosité dans cette famille : je repars chaque jour avec des légumes, parfois même des fruits pleins mon sac, de quoi nous alimenter pour le reste de la semaine. Ils mettent un point d'honneur à ce que « ma » famille ne manque de rien, nous permettant de nous alimenter qu'en légumes biologiques, ce qui reste une vraie performance dans ce pays. Je l'avoue, c'est aussi ça qui m'a fait rester, car même si j'ai appris certaines choses, le rythme du travail ne permettait jamais quelques pauses explicatives. Et j'attendais quand même ce dernier jour de travail comme une espèce de libération. Arrivé au portail, je le trouve fermé, sans aucune explication. 24 kilomètres pour rien : au retour, je trouve un mail envoyé le soir précédent, me disant qu'il n'était pas la peine de venir, vu les intempéries. Point. Personne ne va pleurer de cette perte, on ne se reverra plus, rideau.
A la maison, nous commençons à envisager le fait que l'hiver puisse toucher à sa fin. Un matin, Maïa accourt vers sa mère : « Maman ! Viens voir, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le jardin ! » En fait d'extraordinaire, il s'agira d'un phénomène qu'on n'en pouvait plus d'attendre : des bourgeons sur les arbres. Mais un bourgeon ne fait pas le printemps, et nous n'en pouvons plus de voir que les belles journées ensoleillées sont suivies presque systématiquement par des averses diluviennes ou des tempêtes nous rappelant qu'El Nino sévit bien dans le coin. Ces belles journées, c'est comme le morceau de sucre qu'on pointe au-dessus du museau du chien, juste histoire qu'il se lèche les babines. Et vraiment, il n'y a rien de plus cruel.
Le dernier épisode pluvieux fut interminable, le linge sale s'accumulait, la maison s'imbibait d'eau, par les murs en torchis dont il manque une couche protectrice, et qui menacent chaque fois de s'écrouler tout seul, sans compter les trous qui apparaissent, ici et là. Dehors, les chemins du barrio sont, dans ces conditions, incapables de recevoir le ciel qui nous tombe sur la tête. Dans ce cas, quand il s'agit de sortir le nez dehors, le jeu consiste à trouver un itinéraire pour arriver à destination sans tomber sur une route coupée par un étang apparu au milieu de la chaussée pendant la nuit. Nous pensions quand même l'avoir touché du doigt, ce satané printemps, le week-end dernier, lorsque Dumas, le gérant du camping, devenu ami, nous invita pour un asado célébrant notre départ proche sur les routes. Nous ne l'avions vu qu'en manteau, là, il nous reçoit en combo short – tee-shirt, sous un soleil radieux. Bon signe. Et puis non : deux jours plus tard, El Nino, cet enfant décidément bien mal élevé, refait des siennes. Une tempête incroyable, qui nous empêchera d'avancer sur nos vélos, au point que Maïa, confortablement assise dans sa carriole telle une duchesse s'en inquiétera auprès de sa mère : « Maman, pourquoi tu n'avances pas vite? »
Le soir, c'est la mauvaise branche qui décidera de craquer : elle coupera net le précieux fil nous reliant sauvagement au réseau électrique. Dans nos conditions de clandestinité, inutile de préciser que nous n'allions pas appeler la compagnie d'électricité. Heureusement, Nando, l'ami d'Aude qui habite en face, sera très compréhensif et, comme après chaque tempête ou presque, il ira grimper le lendemain matin sur le poteau électrique, risquera sa vie à débrancher le fil, afin de le rafistoler ensemble, avant qu'il ne risque sa vie une deuxième fois pour le remettre, sous les yeux d'une fourgonnette de la compagnie d'électricité qui passait par là, mais qui décida de ne pas nous voir. Ouf. Et merci, Nando.
On comprend que les Uruguayens sont, dans ces conditions climatiques, particulièrement casaniers. Et la police locale en profite : les sirènes des véhicules des gardiens de la paix, toute relative ici, remplacent alors les coups de feu nocturnes. C'est la chasse aux bandits, et c'est un poil plus rassurant. Un jour, alors que Céline amenait Maïa à l'école, elle est témoin d'une arrestation dans les règles : sortant d'une maison en tôle, misérable et sans fenêtre, deux policiers entourent un présumé malfrat, menotté aux mains et aux pieds, pour les 5 mètres de trajet jusqu'à la voiture. Ici, ça ne rigole pas avec les procédures. Parfois...
Entre deux intempéries, nous recevons Emmanuel à la maison : Brésilien, il est parti de Porto Alegre pour parcourir l'Amérique à vélo, jusqu'au Canada. Rien que ça. Rencontré via Warmshower, un genre de Couchsurfing pour cyclistes, il devait rester une nuit. Il restera une journée et une nuit en plus, ce qui lui évitera une noyade assurée. Le Canada attendra bien 24 heures. Emmanuel est le genre de personne qui sait rendre les choses faciles. Cycliste, il ne l'était pas vraiment avant de partir. « Je me suis renseigné, c'est tout. Et j'ai acheté un vélo en pièces détachées ; c'est en le montant que j'ai appris le fonctionnement du truc. » Il a avalé 1000 kilomètres, déjà, mais il lui en reste quelques autres milliers, avec un équipement, heureusement, bien plus évolué que le nôtre.
Si ce n'est pas un temps à mettre un Uruguayen dehors, une seule chose peut les faire sortir de chez eux, affronter la pluie et la tempête : le Football. Avec un grand F. Alors qu'une tempête était annoncée, nous n'étions pas loin de remplir les 100 000 places du stade Centenario lors de la rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde entre l'Uruguay et le Paraguay. Bien plus qu'un match, ce fut l'occasion de découvrir un véritable monument historique. Construit pour la première Coupe du Monde, en 1930, et en un temps record - « aujourd'hui, les Uruguayens ne pourraient jamais le refaire » témoigne, désabusé, le réparateur de vélos du coin – il est resté tel quel, depuis près d'un siècle. Alors que les stades européens se rénovent, se reconstruisent, deviennent de vrais parcs d'attractions, namé – comme ils disent - par les grands marques d'assurances ou de paris en ligne, pour faire rentrer le football dans l'ère de l'entertainement – comme ils disent aussi -, attirer des classes sociales toujours plus aisées, celles capables de débourser une fortune pour un match ; ici, le foot reste simplement une passion. Une passion populaire. Rien n'a changé depuis 1930 : le couloir menant aux gradins transpire des générations de supporters ayant emprunté ces escaliers ; seule l'affiche proposant les tortas fritas permet de nous situer – à peu près – au 21ème siècle. A l'intérieur du stade, nous sommes à l'extérieur : le Centenario n'ayant pas de toit, les supporters sont logés à la même enseigne que les joueurs, c'est-à-dire sous des rafales de vent humides ce jour-là.
Dans un stade, l'Uruguayen reste plutôt tranquille. Jusqu'à ce qu'il y ait un but pour la Celeste, son équipe, que dis-je, sa vie. Au grand dam des oreilles de Maïa, qui se demande bien pourquoi, d'un coup, tous ces énergumènes autour d'elle s'excitent alors que son joueur préféré, Cavani, vient de claquer un doublé. On ne saurait lui donner totalement tort. Amusé, un supporter derrière nous, ravi du 4-0 infligé au voisin paraguayen, nous ordonnera de revenir au prochain match : « c'est la petite qui nous porte bonheur, se marre-t-il. Il faut qu'elle soit là contre le Venezuela! » Pour que Cavani marque deux buts, il y a effectivement comme un petit goût de miracle.





























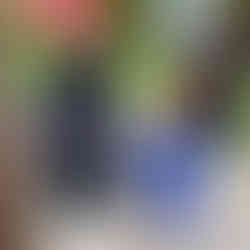



























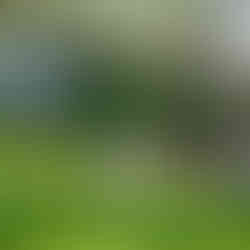



































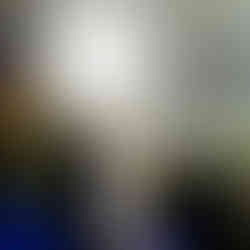























Commentaires