Baleines et chauve-souris
- urbedall
- 13 oct. 2016
- 8 min de lecture
Voilà un jeu qui demande de la patience. Beaucoup de patience. Nous comprenons maintenant pourquoi le tourisme de la baleine n'est pas vraiment développé en Uruguay : c'est qu'il faut avoir du temps, dépendre de la bonne volonté de ces majestueux animaux des mers. Deux paramètres que ne peut supporter le tourisme de masse, mais que nous acceptons, nous, avec philosophie. Il faut dire aussi que nous avons ce luxe inestimable d'en avoir, du temps, à défaut de pouvoir commander aux baleines de s'approcher un peu du bord. A notre arrivée à La Pedrera, nous rencontrons Adriana, dynamique quinquagénaire à l'origine de cet attrait uruguayen pour la baleine. « J'en avais vu en Italie, il y a une trentaine d'années, et quand je suis rentrée ici, je me suis demandée pourquoi il n'y avait rien à ce sujet dans mon pays. » Alors, elle décide de s'installer à La Pedrera et de suivre l'évolution de ces cétacés, dans l'indifférence générale, pendant presque 20 ans. Jusqu'à ce que d'autres la suivent. « Mais j'ai été la première, hein ! » se permet-elle de préciser. Surtout, Adriana le fait par passion. Elle aurait pu ouvrir une agence touristique, faire balader les touristes en barque, mais non : montée sur son antique vélo, équipée de deux paires de lunettes et de jumelles, elle balaie inlassablement la côte. Et répond aux questions des visiteurs. Comme ça, parce qu'elle aime ça. « Vous avez de la chance : comme il y a eu une tempête ces derniers jours, peut-être que certaines vont pointer le bout de leur nez maintenant qu'il fait meilleur. » Alors, nous suivons ses conseils et nous nous installons sur la plage, tous les jours, de 11h à 17h, à faire le guet, en faisant parallèlement la classe de mer à Maïa, lui apprenant notamment l'alphabet sur le sable. N'allez pas croire qu'elle chôme, notre fille.
Malheureusement, nous comprenons aussi qu'Adriana a été optimiste, sans doute parce qu'elle veut aussi en voir, de ses amies les baleines. A force de parler avec les locaux, comme la jeune gérante du camping qui nous avait loué sa maison pour une bouchée de pain d'ici il y a six mois et qui nous remercie encore pour « votre » dulce de leche (comprenez le caramel au beurre salé), la réponse est toujours un peu la même : « Ah, qui sait, avec un peu de chance ? ». Sous-entendu : la saison est finie les copains, vous faites pas trop d'illusions quand même ».
Finalement, deux d'entre elles finiront par se montrer, à l'heure du repas, déclenchant une drôle d'excitation chez Céline, visiblement bien plus enthousiaste que Maïa. Nous verrons deux ailerons, une tête, un bout de corps. De quoi mesurer la chance que nous avions eu, il y a sept ans au Mexique, de voir l'une d'entre elles passer en-dessous de notre barque et même de pouvoir la toucher. Céline, qui voulait absolument que sa fille puisse en voir une, n'est pas tout à fait satisfaite, tant le moment fut furtif. Ce sera la fille qui consolera la mère : « Tu sais, maman, on a vu la tête, c'est déjà bien, hein. » Sois (une) sage, qu'ils disaient.
Durant cette semaine, nous trouverons à loger dans une petite résidence secondaire louée par un certain Diego, qui habite Montevideo. Le genre de truc pas cher, mais où, en gros, il faut faire le ménage et éventuellement cohabiter avec les souris la nuit venue. Mais Diego est coopératif : une fois que nous aurons montré, tranquillement, à l'uruguayenne, notre insatisfaction, il nous proposera de rester deux nuits de plus. Le prix, sans doute, d'un bon gros ménage. C'est son voisin, Nacho, qui nous accueillera et nous ouvrira la porte. Lui habitait Montevideo et est venu s'installer ici, d'abord pour y construire la maison de sa grand-mère. Puis pour y rester. Nacho est le genre de type qui ne tient pas en place, c'est même une épreuve pour les yeux de suivre une discussion avec lui, tant sa tête part à gauche, à droite, tel un boxeur cherchant l'ouverture. Un soir, nous l'invitons à l'apéro, et il finit par tout nous dire : accro à la pasta base, la drogue du pauvre, cette saleté qui rend fou des gens prêts à aller voler une bouteille de gaz pour avoir leur dose, il fuira Montevideo et ces tentations faciles. « ça fait trois ans que j'ai arrêté. Mais je peux vous dire, j'ai toujours envie. Je me calme comme je peux, mais c'est très dur ». Nacho a trouvé refuge dans la gentillesse et la générosité. S'il était intoxiqué à la drogue du pauvre, c'est, d'abord, parce qu'il était pauvre. Et ça, il l'est toujours. Mais il donne tout ce qu'il a, sa maison étant un repaire pour voyageurs : « je vais souvent jusqu'à la route principale, voir si je ne vois pas de voyageurs à pied, à vélo. Je leur propose de venir dormir s'ils le veulent. Ici, à part l'été, on ne voit pas grand-monde, ça me permet de rencontrer des gens, et de voyager aussi, à travers eux. » Arrivé de Montevideo sans aucune compétence, comme il le dit lui-même, il apprendra d'abord en faisant la maison de sa grand-mère. Puis en faisant son potager. Aujourd'hui, il jongle pour finir le mois, entre ses légumes et quelques petits boulots dans la construction ou à vendre ses pizzas sur la plage, l'été. Et retourne de temps en temps à la capitale, voir son fils, qui le rejoindra dans quelques années, Inch'Al'uruguayenne. Nacho, c'est le combat ordinaire du pauvre d'ici, à qui on ne peut que souhaiter du bonheur, tant le fossé est grand entre les turpitudes de sa vie et la bienveillance de ses intentions. La prochaine fois qu'on passera par là, une autre maison nous attend. Sans ménage à faire, et un cœur gros comme ça comme comité d'accueil.
Et puis, il a fallu repartir. De cette reprise de pédale, nous en déduirons une réflexion philosophique:nous ne pouvons pas toujours avoir le vent dans le dos. Sauf que sur nos biclous, on n'a pas le temps de philosopher et que ça, c'est du premier degré. Le printemps est venteux, nous avait-on averti. Tant mieux, nous étions-nous dit lors de notre périple jusqu'à la Laguna de Rocha, ou ce souffle divin nous avait emporté, nous transportant pendant 70 kilomètres ce jour-là. P..... de vent de m...., qu'on s'est dit lors de cette étape qui aurait dû être « relax », avec 45 petits kilomètres à faire. Tu parles : chaque coup de pédale ressemblait à un des douze travaux d'Hercule, et ça reprenait à zéro au treizième. Derrière, Maïa, qui a décidé d'apprendre l'écriture, me demande les lettres des mots qu'elle écrit sur ce qu'on a baptisé sa « tablette » – un petit tableau blanc sur laquelle elle dessine (et écrit désormais) avec un marqueur. Je m'époumonne à lui crier les lettres, tout en appuyant comme un forcené sur les pédales : « un A ! un C !.. » L'école à la maison ne doit pas être de tout repos, mais l'école en carriole, je vous dis même pas.
Nous arrivons finalement à Aguas Dulces, petite cité touristique l'été, qui nous fait bien mesurer l'extrême saisonnalité de cet Uruguay du bord de mer : c'est une ville-fantôme qui nous accueille, tous les hôtels, restaurants, bars, fermés ; des dizaines de panneaux « alquilo » (« je loue ») nous fait cependant penser que ce calme effrayant n'est pas due à une quelconque attaque de l'armée de Bachar El Assad. En réalité, tout le monde était au terrain de foot, pour voir les jeunes du club défier l'équipe de Castillos, la ville d'à côté. Tout le monde, c'est-à-dire une trentaine de personnes. Là, nous demandons s'il serait possible de planter notre tente, et, comme sur le terrain, tout le monde se renvoit la balle : d'abord le policier de faction, qui nous suggère de « voir le responsable » du club, puis les trois ou quatre dirigeants de ce club ayant sans doute importé la démocratie corinthienne tant aucun de nos interlocuteurs ne veut se voir attribuer le titre pompeux de responsable. Finalement, Alejandro nous proposera de rester, avec un grand sourire, et nous donne même son n° de téléphone, « au cas où il y ait le moindre problème ». Sur le terrain, la combativité légendaire des Uruguayens ne se dément pas. Et des Uruguayennes également, presque aussi nombreuses que les garçons. Alejandro nous explique que jusqu'à treize ans, filles et garçons jouent ensemble, et cette proportion de filles ne l'étonne guère. Si l'Uruguay est sans aucun doute une société machiste, il semblerait que le football, lui, soit bien plus universel ici qu'en Europe. Aguas Dulces affronte le Nacional de Castillos. Nacional, comme l'un des deux clubs phares du pays. Je demande à Alejandro :« c'est une succursale du club de Montevideo ? ». « Non, me répond-il. En fait, ceux qui ont créé le club étaient fans du Nacional, alors ils l'ont appelé comme ça. Ça se fait beaucoup ici ». Un peu comme si en France, il y avait l'Olympique de Marseille du Faouët et le Paris-Saint Germain du Relecq-Kerhuon. Ici, le football transforme tout le monde en de grands enfants.
Nous nous installons donc à côté du terrain, et profitons même du luxe de profiter des bancs et des tables du stade, des toilettes à la turque des vestiaires, et même le wi-fi public pour regarder nos mails, même si on se serait bien passés de cette bonne dose d'ondes dans notre cerveau pendant notre sommeil.
Le lendemain, les jambes sont encore lourdes de l'étape de la veille, et nous décidons de faire les fainéants : Mochi, que nous avions rencontré lors de notre première visite dans le coin, habite à une quinzaine de kilomètres, et nous décidons d'aller frapper à sa porte. Elle nous reçoit avec un immense sourire et la sincère joie de nous revoir : « je sors de la sieste, j'ai l'impression de rêver encore ! ». C'est un vrai bonheur de revoir Mochi, sa personnalité et sa bienveillance hors du commun. Même si elle nous semble parfois un peu trop perchée, elle a ce don si rare de savoir ne pas se prendre au sérieux, nous faisant nous sentir à l'aise même si nous n'épousons pas entièrement sa façon de penser et de voir le monde.
C'est Maïa qui voulait absolument revenir, histoire de revoir Sol, le petit chien de Mochi que nous avions failli prendre avec nous jusqu'à Aigua lors de notre précédente visite. Ces retrouvailles confirment l'attachement de Maïa pour ce chien en particulier, parmi les innombrables cabots de toute sorte qui sortent de partout à tous les coins de rue . D'ailleurs, le lendemain, la sentence tombe : « Papa, Maman, je veux un chien. Blanc, avec un collier rouge ».
En attendant, elle aura aussi fait la rencontre des brebis de Mochi, leur donnant même, émerveillée, le biberon. Deuxième sentence, le jour d'après : « et aussi des brebis ».
Mochi nous propose d'occuper la maison de Julian, son fils, parti en Argentine pour un moment. Charmante petite chaumière de l'extérieur, ce n'est pas exactement ça à l'intérieur. Étonnamment, Céline, plutôt prompt à sentir les mauvaises ambiances, accepte l'invitation. Nous décidons de faire un brin de ménage, mais abandonnons l'étage face aux crottes de chien pourris sur le matelas de Julian. Avant de repartir, Mochi nous précise : Ah oui, j'oubliais, il y a une souris qui vient par ce trou (elle montre un trou béant dans la plancher) mais normalement, elle n'apparaît pas quand il y a du monde ». Céline commence alors à pâlir, et cherche immédiatement un meuble pour boucher le trou. Peine perdue : ce seront ses camarades volantes qui l'empêcheront de dormir, passant leur temps à raser nos crânes et nos cheveux. Vers deux heures du matin, je me lève.
« Où tu vas ? » me demande Céline.
« Ben pisser. Dehors » je réponds.
« ça fait trois heures que j'ai envie. Mais je peux pas bouger. Je peux pas dormir non plus. P...., t'as vu ces chauve-souris??! »
Comme je suis réveillé, et éventuellement témoin d'un assassinat par une chauve-souris sanguinaire, elle décide d'aller aux toilettes – en fait, une bassine avec de la sciure, posée dans la pièce d'à côté. Soudain, un cri transperce la nuit : « Y en a une dans les toilettes !! ».
Céline fera une nuit blanche, terrorisée, attendant avec impatience le lever du soleil et le coucher de ces sales bêtes. Maïa, elle, dormira comme un ange. Sans se rendre compte le moins du monde de ce qu'elle vient de vivre : elle aura passé sa première nuit dans une maison de sorcières. Et sa dernière, ajoutera sa mère.

































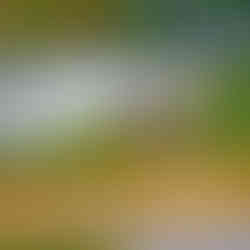































































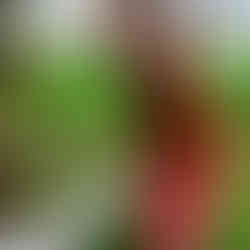





































Commentaires