« C'est pas un travail, c'est un truc communiste »
- urbedall
- 19 oct. 2016
- 8 min de lecture
« C'est pas un travail, c'est un truc communiste »
Un superbe temps de printemps nous accompagne lors de cette ultime étape jusqu'à Punta del Diablo. Nous nous étions jurés de ne plus dire de mal de nos biclous s'ils nous envoyaient jusque là. C'est chose faite, et on leur dit un grand merci. Même si... Non, rien.
Arrivés sur le petit port de cette Pointe du Diable, nous avons cette incroyable sensation que, quoiqu'il arrive, nous ne nous sommes pas trompés de destination. Ce lieu porte un lui un on-ne-sait-quoi de mystique, avec cette mer s'écrasant abruptement sur de majestueux rochers, les cabanes multicolores environnantes et ces bateaux de pêcheurs qui nous font revenir avec bonheur au siècle dernier. Quelque chose de brut et de tranquille à la fois, une puissance mélancolique qui nous fait ressentir un brin de côte bretonne. A Punta del Diablo, on est un peu chez nous, donc. Et ça se fête : Tabaré tient l'unique bar ouvert toute l'année sur la rue du port - un chemin de terre en fait, qui rajoute encore un peu plus d'authenticité au lieu – et vend des caïpirinhas à un prix imbattable. « Vous avez vu cette vue ? Pourquoi est-ce que je fermerais ma boutique, j'ai le plus beau paysage du monde en travaillant ! », nous explique-t-il, en nous servant le traditionnel breuvage brésilien, avec une dose de cachaça bien généreuse qui nous fait prendre conscience que de la Bretagne, nous avons aussi perdu cette résistance éthylique qui nous fait tenir en cas d'intempérie. Ça tombe bien, d'après Tabaré, natif d'ici et (très) fier de l'être, ici, il fait toujours beau : « y a eu des tornades, un hiver pourri en Uruguay. Eh ben ici, rien, que du ciel bleu. » On se rendra quand même compte rapidement du don d'exagération du gars du coin.
En attendant Nacho et Judith, qui arrivent le jour-même de Rosario, pour nous installer tous ensemble à l'hostel où je vais travailler cet été, nous nous posons à côté de l'école publique. C'est l'heure de la récré et une petite fille, sans aucune gêne apparente, propose à Maïa de se glisser en-dessous du grillage : « tu viens jouer avec nous ? » Voilà notre fille squattant une cour d'école, bien visible car étant la seule ne portant pas de blouse, sous le regard totalement désintéressée des maîtresses, surveillant de loin cette dynamique marmaille. Ici, les cours se déroulent entre deux récréations, celle-ci ayant bien duré trois quart d'heure. Finalement, Céline ira chercher notre fille avant qu'elle ne se range avec ses nouvelles copines pour la reprise des cours. Qu'il est beau de ne pas se poser de questions, parfois.
Le soir venu, nous retrouvons Nacho et Judith à leur hôtel « Vente al Diablo » (« va-t-en au diable »). Pas le moindre, ni le seul d'ailleurs, des paradoxes de Nacho, ayant baptisé son hôtel du nom le plus inhospitalier qui soit pour être en fait l'endroit le plus accueillant qu'on ait trouvé lors de notre premier périple. Ce type d'hôtel est ici appelé « hostel » ou « hostal », en gros une auberge de jeunesse pour tous les âges, où sont proposées chambres en dortoirs ou privatives avec une cuisine commune. Cela fait quatre ans que Nacho, notre ami argentin, l'a créé, et c'est lors de nos retrouvailles à Rosario qu'il nous a proposé de le rejoindre pour travailler avec eux. Nous retrouvons également Judith, sa compagne catalane, avec quelques kilos en plus. Des kilos heureux : le couple attend un heureux événement pour début mars, soit juste après le gros de la saison touristique. Autant dire qu'ils vivent ces temps-ci des moments particuliers, mais avec une tranquillité toute latino.
Ensemble, nous commençons à aménager leur hostel, à le nettoyer et l'aérer après un hiver quand même très humide en dépit des affirmations de Tabaré, à l'astiquer, à le repeindre, à le réparer. Nous travaillons quelques heures par jour, plutôt bien, en échange du logement et des commodités plutôt luxueuses pour nous après l'épisode Marindiesque, comme par exemple une machine à laver qui fonctionne toute seule et qui sait rincer le linge. Un truc de ouf. Tout le monde s'y met, jusqu'à Maïa, s'improvisant experte dans le nettoyage des vitres, refusant qu'un seul carreau de l'hôtel ne se fasse sans elle. Un jour, avec un peu de mauvaise foi, je la remercie pour son travail « qui m'aide beaucoup » - en fait, surtout content de voir qu'elle peut trouver du goût à vouloir aider les autres. « Ce n'est pas un travail, me répond-elle sûre de son fait, c'est un truc communiste ! ». Promis, juré, craché, je ne la fait pas étudier le Capital clandestinement. Bien trop soucieux des rythmes de l'enfant, j'attendrais qu'elle ait six ans pour cela.
Il faut dire qu'ici, le sujet est au cœur des discussions : Nacho est anarchiste, ou se réclame comme tel, de ceux pas très attachés à la théorie mais plutôt aux bons côtés que cela procure : la liberté, la jouissance pour tous, la responsabilité pour chacun. Car ça oui, Nacho est un jouisseur, alerte et optimiste, cherchant toujours le plaisir, adorant ce que peut procurer les nouvelles technologies tout en s'affirmant un élève d'Henry David Thoreau, l'un des papes de l'ascétisme. Même si cela engendre quelques incohérences conceptuelles, il vaut mieux s'en amuser, et nous le faisons, rebaptisant la caisse commune pour la nourriture la « caisse communiste », décidant à l'unanimité de ne pas faire appel au FMI pour l'abonder lorsque celle-ci se retrouve vide. Il faut dire que personne mieux qu'un Argentin ne sait ce qu'impliquent les recettes du FMI.
Aux vues des travaux qu'impliquent l'ouverture de l'hôtel, nous abandonnons notre rêve de passer la frontière brésilienne à vélo. Ce sera dans la voiture de Nacho que nous irons jusqu'à Chuy, cet Hong-Kong local, affreuse ville-frontière gavée de free shops, proposant des produits détaxés pour... les touristes. Car un Uruguayen ne peut même pas profiter de ces prix cassés, réservés aux touristes, par définition les plus nécessiteux, donc. C'est aussi l'endroit d'Uruguay où la vie est la moins chère, et de loin, la grande majorité des produits étant brésiliens. A 40 kilomètres à la ronde, tout le monde va donc faire ses courses à Chuy, permettant de faire de substantielles économies, et nous n'allons pas nous en plaindre, même si parcourir ce dédale d'hyper pas super relève, pour nous, du parcours du combattant.
Arrivés à la douane, l'agent en poste prend son temps. Comme tout Uruguayen. Mais au guichet d'une douane, c'en est très désagréable. Et il n'y a rien de pire que de voir un douanier froncer les sourcils. Et le voilà qui prend son agenda, et compte les jours. Tout à coup, je me rends compte que trois mois ne font pas 90 jours. Prise de conscience tardive de la composition du calendrier romain : lors de notre précédent passage de douane, alors que je passais en même temps à ma trente-sixième année, nous nous étions dits que nous avions donc jusqu'au 9 octobre pour traverser la frontière, oubliant de ce fait que les mois de juillet et d'août se composent de 31 jours. Nous sommes le... 7 octobre. Soit 90 jours, pile poil. Tellement nuls en maths qu'on ne l'avait même pas fait exprès. Le douanier semble avoir fini de compter en même temps que moi, ses sourcils se détendent et le voilà s'emparant de son arme de libération massive, c'est-à-dire son tampon. Jusqu'à ce que son collègue, sans doute en manque de travail vu le peu d'affluence en cette période, examine lui aussi nos passeports, intrigués par autant de tamponnage. « Bon, là, si vous restez plus de trois mois, va falloir faire une demande de séjour, quand même ». Au prochain passage, en janvier, on va prier pour ne pas voir de sourcils se froncer.
Si Punta et ses plages possèdent un charme terrible, nous nous apercevrons vite que c'est aussi un village de pêcheurs qui s'excite, comme toute la côte, deux mois dans l'année. En dehors de cette période touristique, la bourgade est envahie d'une douce torpeur. Le samedi soir, nous décidons de retourner chez Tabaré, pour savoir notamment si cet air de Bretagne se retrouve aussi dans le seul bar du coin. Pour le coup, il n'en est rien : nous sommes les seuls attablés à boire la caïpirina – qui devient dangereusement notre boisson favorite – à faire comme le patron, c'est-à-dire à admirer le port, la mer, et la pleine lune qui s'y reflète majestueusement. Une voiture neuve s'arrête, quatre filles en sortent, commandent 4 de ces fameux cocktails brésiliens, puis repartent en sirotant leurs verres, conductrice y compris, prenant le bar de Tabaré pour un vulgaire CaïpiDrive. Deux minutes plus tard, une voiture brinquebalante passe, l'auto-radio crachant une cumbia tellement forte qu'elle cache le bruit d'un moteur pourtant très expressif. Un tas de ferraille qui tient miraculeusement sur ses roues, avec un feu de recul comme seul luminaire à l'arrière, pour une voiture qui, pourtant, avance. A Punta del Diablo, on reconnaît aisément les touristes des locaux.
Au bar, c'est d'abord Annibal qui nous sert - « c'est mon père qui a voulu m'appeler comme ça ; c'est un guerrier, j'crois, j'ai toujours voulu lui demander mais maintenant, il est mort ». Lui est arrivé de Montevideo, après avoir vécu en Espagne, aux Etats-Unis et en Biélorussie. « Mais là-bas, ça caillait trop. Je me suis barré et manque de bol, la neige est arrivée deux semaines après. J'ai toujours jamais vu la neige, c'est con. » Le pays lui manquait trop, alors il a décidé de poser sa caravane ici. Et se remet à peine de son premier hiver : « plus que le froid, c'est qu'il n'y a pas de boulot par ici. Mais quand je dis pas de boulot, c'est vraiment rien de rien. J'ai été m'occuper d'un jardin, j'y avais passé toute la journée, et à la fin, la dame me sort un billet de 200 pesos (6€). Je croyais qu'elle s'était trompée de billet, moi ! » Non, elle ne s'était pas trompée. Autant le lieu offre des paysages de cartes postales, autant son économie, comme celle de toute la côte, est basée exclusivement sur le tourisme, ce qui engendre des situations de précarité quasi-dramatiques l'hiver venu. Mochi nous avait dit qu'elle sortait d'une période « de survie ». C'est ce que font la plupart des Uruguayens du bord de mer, en attendant les jours meilleurs.
Tabaré, lui, est un local. Pur jus. Ses parents étaient les premiers à avoir la télé ici. Quand ? « au début des années 90 ». Devant notre étonnement, Tabaré explique : « avec la dictature, les télés sont arrivées très tard par ici. Et du coup, à l'époque, tous les gens venaient à la maison, ramenaient des gâteaux, du café, du maté, et on regardait tous ensemble la novela. » Tabaré nous parle d'un temps où la télé pouvait devenir un moyen de communication et de convivialité. Avec lui, nous semblons toucher du doigt l'esprit de ce village de pêcheurs. Taiseux mais sociable, il n'en dit jamais trop. Observe, jauge les gens, pour savoir s'il peut leur faire confiance, si ça vaut le coup d'en savoir un peu plus. En un quart d'heure, il proposera tout naturellement à Céline de venir tester ses crêpes dans sa gargote. En mode : à prendre ou à laisser, c'est comme tu le sens, je propose, après tu vois.
C'est désormais vérifié : à Punta del Diablo, on ne parle pas beaucoup, mais on parle le brestois.

























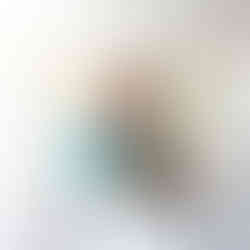



















































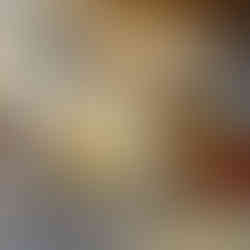





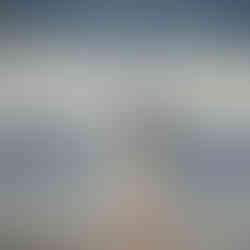























Commentaires